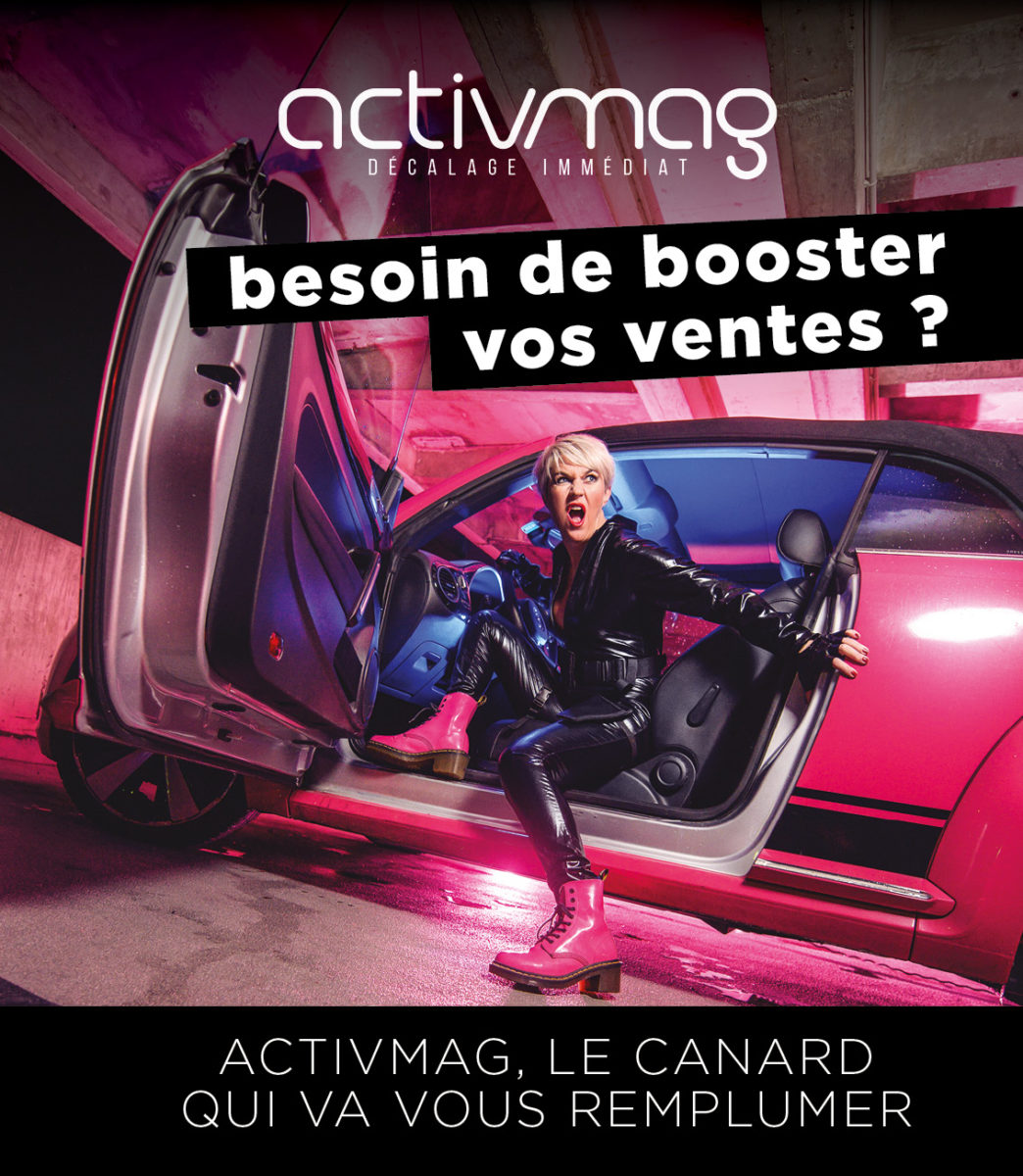UN DESTIN FAIT BAINS
Sans être connue pour ses bouteilles d’eau, son hippodrome ou son casino, La Léchère est pourtant la deuxième station thermale savoyarde la plus visitée. Discrète, mais efficace, elle est aussi la dernière-née… Sortie des eaux.

« Fin XIXe, La Léchère n’était qu’un lieu-dit, pas même un hameau« , décrit l’historien spécialisé dans le tourisme, Marc Boyer. “Il dépendait d’un bourg industriel situé de l’autre côté de l’Isère, Notre-Dame-de-Briançon. Des eaux exceptionnellement chaudes (à 63°C) jaillissant (ndlr : à la suite d’un affaissement du terrain qui fit apparaître deux étangs), quelques paysans les utilisaient pour forcer leurs récoltes de légumes et de fraises. En 1890, il y eut un très petit essai d’exploitation. Le notable local n’avait pas d’argent, un petit café-hôtel et une baraque appelée thermes n’attira pas grand monde, si ce n’est des habitants du lieu pour prendre des bains de propreté.”* Dans le style d’une villa normande, ce petit Hôtel des Bains de 12 chambres fait tout de même travailler les gens de la vallée. Il jouxte donc les grandes serres des forceries, chauffées à l’eau thermale, dont les premiers melons seront expédiés à Paris en 1913.
UNE STATION BIEN EN VEINE
En 1925, le couple parisien Jean et Fira Stern tombe amoureux de l’endroit et le rachète. Il fait raser les premiers thermes pour en construire de nouveaux : appelés les «thermes blancs». Ils sont surmontés d’une tourelle crénelée aux allures de minaret, qui leur donne un style mauresque. Une nouvelle villa sert d’annexe à l’hôtel avant que ne soit érigé, en 1931, le Radiana, impressionnant bâtiment de six étages, «paquebot au milieu des monts», dont les motifs floraux et géométriques sont typiques de l’architecture Art Déco.
Malgré la crise, la station démarre rapidement. Quelques particuliers ont ouvert de petits hôtels et meublés qui viennent compléter les 200 chambres de la société des thermes, mais ce n’est pas suffisant. Les curistes doivent retenir leur lieu de résidence longtemps à l’avance ou se loger dans les environs, jusqu’à Moûtiers ou Brides. Ce ne sont pourtant pas les distractions -il n’y a pas de casino- ni les mondanités -même si les familles royales belges ou suédoises sont devenues des habituées- qui attirent dans cette vallée. Ce n’est pas non plus le charme du site, car les deux rives de l’Isère, à un kilomètre en aval du complexe thermal, sont occupées par des usines et une centrale électrique ! Si les gens ayant de mauvaises veines viennent à La Léchère, c’est vraiment pour les bienfaits de l’eau, la qualité des soins et l’expertise en phlébologie. On y croise donc plus de curistes que de touristes, ce qui est assez inhabituel pour l’époque.

DESTINÉE COMMUNE
Cette clientèle, plus constante, permet aux thermes de traverser le conflit mondial sans trop de pertes. Les Stern, à qui ils ont été confisqués en 1943, les récupèrent à la fin de la guerre. Ils rénovent l’établissement, agrandissent l’Hôtel des Bains, entretiennent l’ensemble jusqu’à son rachat, en 1985, par le district du Bassin d’Aigueblanche (future Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche – CCVA).
Entre-temps, de lieu-dit, La Léchère est devenue commune : le 30 juin 1972, Notre-Dame-de-Briançon s’est en effet associée à quatre de ses voisines pour former cette nouvelle entité. La réputation de la station en a déterminé le nom. En d’autres termes, la municipalité de La Léchère n’aurait probablement jamais existé sans la découverte des eaux et l’activité thermale.
À la fin des années 80, une extension contemporaine, appelée «thermes bleus» est ajoutée aux thermes et l’Hôtel des Bains est détruit. La Léchère est ensuite intégrée dans le projet olympique d’Albertville : elle accueille les 17 000 m2 du centre de presse international, sur la rive droite de l’Isère, en face des thermes. Un tiers de ce «Village 92» est démonté à la fin de l’événement, le reste est reconverti en salle de spectacles, médiathèque, commerces et logements, reliés au quartier thermal par une passerelle sur la rivière.

RÊVER PLUS EAU ?
“Les thermes ont accueilli jusqu’à 9000 curistes par an, mais la fréquentation a chuté à 5-6000 depuis 1997, suite à un problème de bactérie”, explique Christophe Mansouri, chargé du développement territorial à la CCVA. “Depuis, nous avons fait de gros investissements, dans de nouveaux forages plus profonds, dans la rénovation de l’hôtel et dans la géothermie : les eaux chaudes de rejet sont utilisées pour le chauffage du Radiana et du nouveau spa (ndlr : plus grand spa thermal de Savoie, 1500 m2 inauguré en 2012). Le thermalisme reste donc un de nos piliers de développement. Avec 200 emplois directs, il représente le 2e plus gros employeur du bassin, derrière la station de ski de Valmorel. Et il y a un gros transfert de personnel d’une activité à l’autre en fonction de la saison. La Léchère pourrait donc devenir un camp de base l’hiver, nous avons d’ailleurs lancé une navette gratuite entre les deux cette année. Au même titre que Valmorel, le complexe thermal tient donc une place fondamentale dans notre stratégie touristique des prochaines années”.
*Les villégiatures du XVIe au XXIe siècles – Marc Boyer – EMS Management – Janvier 2008
Image : Jérôme Carret